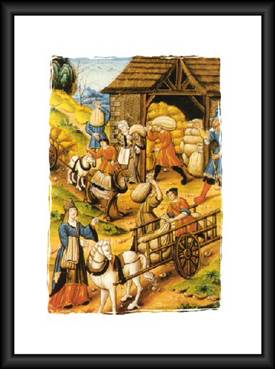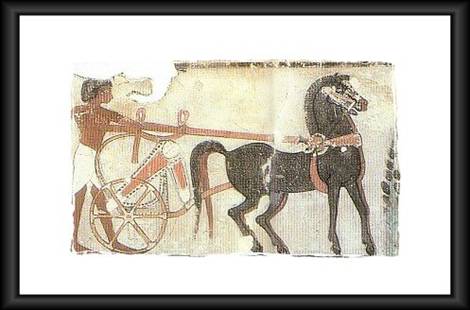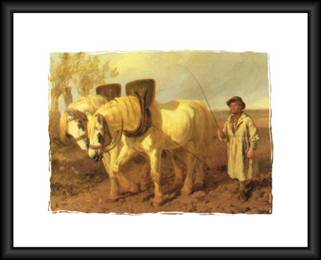![]()

Deux mille cinq
cents ans avant notre ère, l’homme, après s’être attelé au cheval,
attelle celui-ci à son char.
|
De la domestication à l’attelage : une évolution
tardive : |
|
Ø
L’exploitation du cheval pour sa force était inconnue
des hommes de la préhistoire. Et la domestication n’a pas entraîné, dans un premier temps, de
grands changements sociaux. Il a fallu, pour que l’idée initiale prenne corps
et se traduise dans la pratique, qu’apparaissent ses applications et les moyens
de les mettre en œuvre.
Ø
Cela supposait l’existence préalable d’une agriculture assez
développée et d’importants besoins en transport ; cela supposait
également que l’on sût comment et à quoi atteler le cheval. C’est pourquoi
ces techniques, apparues chez les semi-nomades des steppes eurasiatiques, ont
été surtout développées et perfectionnées au sein des premières grandes
civilisations urbaines du Moyen-Orient ancien. |
|
|
|
|
|
L’épopée du char de guerre, instrument décisif de l’issue des
batailles : |
|
Ø
Le cheval commença sans doute par tirer l’araire
et le traîneau à dépiquer, comme le bœuf et l’âne, mais c’est
associé au char à roues qu’il donne, pour la première fois, la mesure
de son utilité. ü Le premier char, à quatre roues pleines, est
attesté à Ur en 3500 avant notre ère. Probablement inventé pour le bœuf,
il aurait été ensuite adapté à l’hémione et à l’âne par les Sumériens, avant
de passer au cheval. Ce lourd véhicule porte un conducteur à l’avant, protégé
par un bord surélevé, et un soldat en armes, sur une plate-forme arrière. Il
est tracté par quatre animaux attelés de front.
ü Puis est apparu le char à deux roues tiré par des chevaux
attelés de front. Du Sahara à l’Asie centrale, son emploi, à
des fins presque exclusivement militaires, domine tout le IIème millénaire
avant notre ère, décidant même de l’issue de plusieurs grandes batailles,
comme celle de Qadesh, sur l’Oronte, en 1285 avant Jésus Christ.
|
|
|
|
|
|
Une utilisation nouvelle du char chez les Romains : les
courses attelées : |
|
Ø
L’utilisation du char de guerre à chevaux s’est
ensuite prolongée jusque sous l’Empire romain, où elle tombe en désuétude,
pour des raisons purement tactiques, face à la maniabilité de la cavalerie et
de l’infanterie, au tout début de notre ère (voir le temps des cavaliers). Ø
Le char est utilisé sous l’Empire romain pour faire
des courses de quadriges. Ces courses romaines se situent à mi-chemin entre les courses
attelés actuelles et les jeux du cirque. Des chars à deux roues et à timons
sont tirés par quatre chevaux attelés de front. |
|
|
|
|
|
L’essor du cheval de trait dans la
société préindustrielle : l’apparition de nouveaux usages et de nouveaux
métiers : |
|
Ø
Au XVIIIème siècle, l’ancien système d’usage
polyvalent de chevaux divers et mal définis, dont l’élevage extensif
était la spécialité des régions pauvres, commence à céder la place, à
une utilisation agricole plus intensive de ces animaux. ü Les chevaux de trait de divers modèles, des plus
aristocratiques aux plus grossiers, sont aussi les plus nombreux sur les
routes et dans les villes : près de 100 000 dans Paris, dont
15 000 à la seule compagnie des omnibus, où leur entretien nécessite des
installations et un personnel considérables. ü Dans les mines, où on les descend une fois pour toutes,
jusqu’à leur mort, des chevaux parcourent chaque jour 20 à 30 kilomètres de
galeries en traînant six ou sept wagons chargés de 4 tonnes de houille ou de
minerai. ü D’autres,
sur les chemins de halage, tirent une péniche de 60 à 100 tonnes sur
une distance allant jusqu’à 30 kilomètres. ü Quant à l’armée, elle entretien en permanence
30 000 à 40 000 chevaux. Pendant la guerre de 1914/1918, on estime
que la seule armée française utilisa 700 000 chevaux, alors même que la
cavalerie ne jouait déjà plus un rôle majeur dans les batailles. Ø
Du fait de l’omniprésence des chevaux, les charretiers, le
cocher, le maréchal ferrant, le maquignon, l’équarisseur, constituent alors
des figures habituelles de la société traditionnelle. |
|
|
|
|
|
L’âge d’or de la traction
hippomobile, un âge décalé au regard des progrès de la mécanisation (2nde
moitié du XIXème siècle) : |
|
Ø
Singulière ironie de l’histoire, il faut attendre la
deuxième moitié du XIXème siècle, c’est-à-dire une époque où les
progrès de la mécanisation des transports et du travail agricole annoncent
déjà la fin de la traction équine pour assister à un essor sans précédent de
la traction hippomobile, notamment en Europe Occidentale. Ø
On voit en effet se réaliser de spectaculaires améliorations dans
le domaine de l’élevage et de l’utilisation des chevaux de traits avec : ü La fixation des grandes races lourdes actuelles, comme le
Percheron en France, le Suffolk en Angleterre et le Rhénan en
Allemagne ; ü La rationalisation de l’alimentation équine, ü Le perfectionnement des attelages et des voitures. |