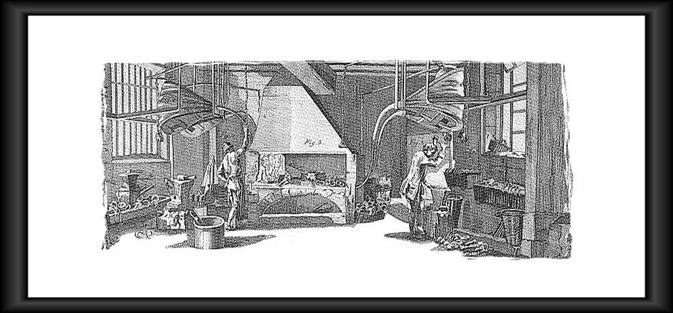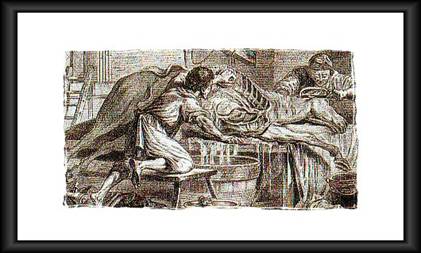![]()

« Je ne
puis terminer l’histoire du cheval sans marquer quelques regrets de ce que la
santé de cet animal utile et précieux a été jusqu’à présent abandonnée aux
soins et à la pratique, souvent aveugles, de gens sans connaissance et sans
lettre. » Buffon, Histoire Naturelle, 1753 : Buffon*, ne
ménagea pas ses critiques aux maréchaux-ferrants et aux savants de son temps.
En effet, les XVIIème et XVIIIème siècles voient une floraison de savants
pataugeant, sous couvert d’exploration anatomique, dans les viscères équins.
* Buffon, Georges Louis comte de
Leclerc, 1707-1788, était un naturaliste français. Auteur de l’Histoire
Naturelle (environ 40 volumes entre 1749 et 1804), organisateur du Jardin des
Plantes de Paris, il conquit le public par son style brillant.
|
Le lent « maldéveloppement », pourtant essentiel, de
l’art de la ferrure : |
|
Ø
Sa morphologie adaptée à la course, qui fait l’originalité et l’intérêt du
cheval, tient essentiellement à son pied constitué d’un seul doigt,
car « pas de pieds, pas de cheval ». Aussi ce pied a-t-il été de
tout temps l’objet d’attention et de soins particuliers. En effet, protéger
l’usure des sabots est nécessaire, d’autant plus que le cheval est appelé à
marcher sur des sols durs et abrasifs (pavés, asphalte). Ø
Mais,
même dans ce domaine essentiel, les progrès techniques se signalent
par leur lenteur. ü Succédant
à l’antique hipposandale, sorte de brodequin en cuir et métal maintenu
par des lanières, à l’usage exclusivement thérapeutique, la ferrure à
clous est l’une des inventions les plus marquantes de l’histoire de
l’utilisation du cheval par l’homme.
Hipposandale ü Pourtant,
elle n’arrive qu’au IXème en Sibérie méridionale, à Byzance et en Europe
occidentale, et ne se généralise en Occident qu’au XIème siècle. Mais les
Chinois et les Japonais l’ignorent jusqu’à la pénétration européenne moderne,
et les Mongols persistent à ne pas l’utiliser. Ø
Mal fabriqués et posés, les fers à clous se révèlent plus
nuisibles qu’utiles. D’où, sans doute, la lenteur de leur diffusion au
cours de l’histoire et par conséquent, la place considérable prise aussitôt
par les maréchaux-ferrants dans toutes les sociétés qui ferrèrent leurs
chevaux. Importance parfois suspecte : l’Inde, le monde musulman ou
l’Afrique continuèrent à isoler en castes ou à mépriser leurs forgerons à
cause du caractère infernal de leur maîtrise du feu et des métaux en fusion.
Fabrication
des fers à cheval, planche de l’encyclopédie, XVIIIème siècle. Ø
La
ferrure est une opération qui peut s’effectuer à la française, le pied
du cheval étant tenu par un aide, ou à l’anglaise, le maréchal tenant
lui-même le pied en s’aidant de ses jambes. |
|
|
|
|
|
De la maréchalerie à la médecine vétérinaire, un art
tardif : |
|
Ø
De l’art de la ferrure à l’art vétérinaire, il n’y a en principe qu’un pas, que
l’on mis pourtant, dans la pratique, très longtemps à franchir.
Jusqu’au XVIIème siècle en effet, et à l’exception de quelques ouvrages
orientaux, les innombrables traités de maréchalerie restent les seules
références sérieuses et les maréchaux-ferrants, les seuls praticiens reconnus
en matière d’hippiatrie. Les ravages causés en Europe par les grandes
épizooties des XVIIème et XVIIIème siècles apportent la preuve de
l’insuffisance de la médecine empirique pratiquée par les maréchaux-ferrants
et déclenchent un vaste mouvement de recherche de nouvelles techniques
thérapeutiques. Ø
Les premières écoles vétérinaires : ü S’ensuit
la création des premières écoles vétérinaires du monde, à Lyon en
1762, puis à Alfort en 1765. le cheval, au centre des
préoccupations animalières de l’époque, joue donc dans cette évolution de
l’empirisme à la science un rôle déterminant. Le fondateur des écoles
vétérinaires, Claude Bourgelat, est un ancien avocat devenu écuyer
du roi à Lyon où il dirige une académie équestre. ü L’anatomie du cheval est connue avant toute autre anatomie
animale, comme en témoignent l’Anatomia del cavalo (1598) de
Carlo Ruini, ou le Cavalier anatomisé (1790) d’Honoré Fragonard
conservé au musée de l’école d’Alfort. Déjà nombreux au XIIème siècle, les
Kitâb al-faras (livres des chevaux) témoignent de l’avance arabe en
hippologie et hippiatrie. La recherche vétérinaire se limitera longtemps à
essayer de transposer aux autres animaux domestiques les connaissances
acquises à partir de l’étude du cheval. Ø
Le réalisme au service de l’anatomie : ü Les
planches ci-dessous sont représentatives de l’engouement pour l’anatomie
qui accompagna, au XVIIIème siècle, les progrès de la médecine,
et particulièrement la médecine vétérinaire, dont le moteur principal était
la connaissance du cheval.
ü Dues
à Harguiniez, qui illustra également l’article « manège », de
l’Encyclopédie, elles sont extraites du monumental Cours d’hippiatrique
ou Traité complet de la médecine des chevaux, de Pierre
Etienne Lafosse* (1772), un fondateur de l’hippologie.
Dissection du
cheval, gravure in Traité complet de la médecine des chevaux, Lafosse. *Fils du maréchal des écuries de
Louis XV, Pierre Etienne Lafosse, né en 1723, commença par devenir, sur
ordres de son père, palefrenier puis maréchal-ferrant. Il apprend l’anatomie
humaine, l’anglais, l’équitation, et s’exerce à la dissection des chevaux. En 1764, on préfère à son projet
d’école de maréchalerie à Paris, le projet d’école vétérinaire à Alfort de
Bourgelat. Déçu, il restera jusqu’à la fin de sa vie à l’écart de toute
fonction officielle, sinon une modeste charge de membre associé de l’Académie
des Sciences. |
|
|
|
|
|
L’approvisionnement massif en
cheval dû à la boucherie des guerres : |
|
Ø
A partir du XVIème siècle, alors que la fin de la féodalité européenne
a ruiné de nombreux élevages privés, les guerres incessantes entraînent
des besoins croissants en chevaux que les pays concernés sont incapables de
satisfaire. ü Dès
cette époque, chroniques et témoignages font état d’importations massives de
chevaux. ü Après
la guerre de Trente ans (1618-1648), le problème de l’approvisionnement en
chevaux devient crucial, il atteint désormais l’Europe entière. Ø
Tous les pays doivent aller chercher leurs montures de plus
en plus loin et les payer de plus en plus cher : ü Durant
les deux dernières décennies du règne de Louis XIV, et pour les seules
remontes de sa cavalerie, la France a importé plus de 330 000 chevaux
et dépensé plus de 100 millions de livres. ü Dans
le même temps, les Chinois et surtout les Russes réalisent des achats massifs
par dizaines de milliers de têtes en Asie centrale, tandis que des flux
d’animaux transitent d’Asie en Europe par Constantinople et du Moyen-Orient
en Inde par le golfe Persique. Ø
Parallèlement,
tous les grands États prennent de sévères mesures pour éviter les
hémorragies de chevaux au travers de leurs frontières : ü Dès
le XIIème siècle, des ordonnances royales interdisent la vente hors de
France des armes et des montures en raison de leur rareté. ü De
même, dans l’Espagne du siècle d’Or, Philippe II ne laissait à personne le
soin d’accorder ou de refuser les exportations de chevaux andalous et
examinait lui-même les demandes. Ø
Le problème de la quantité et du prix se double d’un problème
de qualité : ü L’élevage occidental, jusqu’au XVIIème
siècle, est anarchique, s’effectue en liberté (un étalon est lâché
au milieu des juments), hors de tout contrôle, dans les régions les plus
défavorisées, et produit des animaux inégaux et jugés inadaptés aux besoins. Il
ne permet donc pas un véritable contrôle de la reproduction. ü En
Angleterre, pour favoriser l’élevage de chevaux de guerre, Henri VIII ordonne
la destruction des poneys. De même, l’évêque de Coventry, en 1609, interdit
l’accès du marché de sa ville aux chevaux bâtard. Olivier Cromwell s’offre
son haras, et Charles II, son successeur, introduit la notion de juments
« royales »... |
|
|
|
|
|
Le besoin de relancer et structurer l’élevage pour contrôler
la reproduction : la naissance des Haras Nationaux : |
|
Ø
L’administration des Haras : ü La solution de haras contrôlés par l’État est envisagée pour
la première fois en France sous le règne d’Henri IV. Elle
refait ensuite surface régulièrement comme en 1626. Après ce projet de
redonner vie aux vielles structures de l’élevage équin en y intéressant la
noblesse, Colbert suscite en 1665 et 1668 deux arrêts du Conseil Royal,
véritable acte de naissance de l’administration des Haras en France. ü Le
but, dans un premier temps, est de favoriser le développement de l’élevage
et d’en améliorer la qualité. Le système retenu est simple : le roi
fournit un étalon de qualité à chaque établissements équins. Par la suite, une
série d’institutions nouvelles et de réformes tendront à réglementer
l’ensemble de la production chevaline et à décentraliser les Haras dans les
Provinces. Ø
De la gestion à la théorisation de l’élevage
équin : parallèlement aux tentatives
de perfectionnement de la machine administrative, s’élabore progressivement
une doctrine d’amélioration des animaux. ü On ne raisonne pas encore en terme
de races, au sens technique moderne de populations homogènes d’animaux
dont la reproduction est strictement contrôlée, mais en terme de types de
chevaux. Ainsi, le marquis de Brancas établit une distinction
fondamentale entre le « beau cheval », susceptible de faire un bon
carrossier ou un cheval de cavalerie, et le reste de la production. ü Pour les Haras, il s’agit donc moins
d’améliorer le cheptel existant que d’essayer d’en créer un nouveau, par
apport de chevaux élégants étrangers : chevaux arabes, espagnols...
c’est déjà là l’amorce des débats passionnés du XIXème siècle sur les races
de chevaux, qui donneront naissance à la zootechnie, science de l’amélioration
des animaux domestiques. |